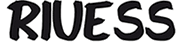|
|
|
|
Appel à communication
Appel à communication des XXVème rencontres du RIUESS (Réseau Inter-universitaire de l’Economie Sociale et Solidaire)
Brest, du 20 au 22 mai 2026 e Brest eus an 20 d'an 22 a viz Mae 2026 Faculté de Lettres et sciences humaines Skol veur al Lizhiri ha Skiantoù an den
IMAGINER DEMAIN : L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,ACTRICE DE FUTURS POSSIBLES ET DÉSIRABLES ?IJINAÑ WARC’HOAZH : AN EKONOMIEZH SOKIAL HA KENSKOAZELL,AKTOREZ UN DAZONT POSUBL HA C’HOANTAET ?
VERSION PDF de l'appel à communication
Le développement de la société industrielle a suscité une série de questionnements profonds sur les bouleversements qu’elle engendrait dans les différentes sphères de la société. En effet, l’industrialisation a radicalement transformé la stratification sociale, introduisant de nouveaux modes de production et d’organisation du travail. Ces mutations ont provoqué, au sein des élites de l’époque, une vague d’interrogations qui ont nourri à la fois le socialisme utopique et les mouvements ouvriers naissants.
Au cœur de ces bouleversements, des expériences de cogestion et de coopération ont émergé, proposant des alternatives aux modèles d’organisation imposés par l’industrialisation galopante. Dans un contexte où les modes de production évoluaient de manière drastique, ces initiatives offraient des perspectives nouvelles et souvent audacieuses. Ainsi, en France, dès 1834, un groupe d’ouvriers parisiens a fondé l’Association chrétienne des bijoutiers en doré, cherchant à mieux s’adapter aux transformations du secteur et à protéger leurs intérêts.
Ces exemples rappellent que les grandes transformations du XIXe siècle ont également donné naissance à des réponses novatrices, qui forment les bases de ce que nous appelons aujourd’hui l’économie sociale et solidaire (ESS). Ces prémices témoignent de l’importance des futurs possibles et des alternatives dans la construction d’une ESS porteuse de changements sociaux profonds.
En tension avec de nouvelles contraintes structurelles pesant sur notre société (globalisation, inégalités systémiques, inerties institutionnelles, …), l'ESS parvient-elle encore, dans son modèle économique alternatif, à incarner la force subversive qui est à son fondement ? Lorsqu’elle invite à la déconstruction des évidences et à l'expérimentation de voies radicalement différentes, l’ESS choisit d’être actrice de futurs possibles et désirables. Dans sa dimension créative, elle tisse des imaginaires collectifs, n’hésitant pas à remettre en question les dogmes et parfois à donner voix aux marges et penser le « Do It Yourself » comme un moteur de transformation sociale, même dans des situations difficiles et dans un environnement hostile.
Dans sa dimension foncièrement contestataire, elle fait rimer la solidarité avec la justice sociale pour forger des futurs désirables en dépit des forces qui tendent à les limiter. Nous pensons à l’utopie concrète ou réelle (voir numéro 359 de la Recma), lorsque l’ESS, résolument anti-conformiste, initie des actions transformatrices dans des domaines tels que : la transition écologique et énergétique, l'inclusion sociale et la lutte contre les inégalités ou encore la gouvernance participative. Le présent appel propose aux contributeurs de revenir sur ces utopies concrètes et les aborder à travers 5 axes. Ces 5 axes sont ouverts aux expériences et aux connaissances élaborées dans d’autres territoires (les Suds) où les contextes sociohistoriques peuvent inviter à questionner les outils conceptuels élaborés dans les pays européens. Dans les Suds, il est souvent difficile, voire impossible, de délimiter clairement le périmètre de l’ESS, en raison de sa forte imbrication avec l’économie informelle. Cela ne signifie pas que toute l’économie informelle relève de l’ESS (Ndiaye, 2025). De fait, l’opposition systématique entre économie informelle et ESS ne permet pas de rendre compte de la complexité des dynamiques économiques contemporaines dans les Suds. Les organisateurs encouragent les contributeurs à proposer des projets dans tous les axes.
Axe 1 : L'ESS au cœur des territoires : entre ancrage local et récits pour demain
Ancrée dans le local, l’ESS se présente comme un acteur au service du lien social et du territoire sur lequel elle se développe. Elle se matérialise à travers une diversité de structures : coopératives, associations, mutuelles et fondations. Nombre d’entre elles sont des organisations qui répondent à des besoins spécifiques et non couverts par le marché traditionnel. Ainsi, en créant des circuits courts, par exemple dans l'agriculture biologique ou l'artisanat, l'ESS réduit l'empreinte écologique et renforce l'autonomie des communautés. Elle est souvent le produit d’une histoire, d’une culture sociale et/ou de solidarités reliées à la singularité d’écosystèmes territorialisés. Plus largement, l’action associative apparaît comme le cadre privilégié de pratiques économiques sociales et solidaires de proximité, sans que cette action soit nécessairement conscientisée ou, encore moins, revendiquée. Le cas des associations sportives représente à ce titre un exemple de choix.
En effet, le secteur associatif sportif est implanté sur un territoire et anime des activités diverses. Toutefois, on peut s’interroger sur sa perception de l’ESS. S’affirme-t-il comme un acteur du secteur ? Dans cette perspective, la dimension territoriale peut être mobilisée pour analyser les formes de régulation locales pour montrer comment les structures de l’ESS s’insèrent dans des logiques spécifiques (Demoustier, 2010). Les modalités de cette insertion affectent-elles la manière de se concevoir comme un membre de l’ESS ? Les territoires dans lesquels les structures de l’ESS sont insérées affectent-ils les récits et les visions pour demain ?
L'ESS en effet peut être considérée comme porteuse d’un imaginaire nouveau, construit à partir de récits locaux porteurs de bénéfices pour le futur. Face aux défis globaux (le changement climatique, les inégalités croissantes, la crise de sens), elle propose la perspective d'une économie au service de l'homme et de la planète (Parrique, 2022), où la coopération l'emporte sur la compétition, pour reprendre un thème cher à Albert Jacquard. Les initiatives de monnaies locales constituent des laboratoires d’expérimentation d’une autre manière d'échanger et de valoriser les richesses produites localement. De tels exemples permettent d’envisager les modalités selon lesquelles les initiatives locales contribuent à interroger le global (Gianfaldoni P., Richez-Battesti N., Fraise L. (dir.), 2024).
Les communications proposées dans le cadre de cet axe pourront également porter sur la géographie de l’ESS, ainsi que sur les notions de « territoire » ou d’espace partagé (Paquot, 2011). Les territoires considérés peuvent être délimités de manière géographique, mais aussi en référence à la vie sociale, économique ou culturelle, sans pour autant épouser des délimitations administratives exactes. À ce titre, les territoires d’actions et de projets de l’ESS interrogent les systèmes et logiques d’actions partagées entre actions publiques, actions privées lucratives et actions sociales et solidaires. Le territoire renvoie également aux spécificités locales du périmètre communal ou de quartier, jusqu’au périmètre régional.
Les communications pourront également interroger la notion d’ancrage local, en précisant ce qu’il recouvre et en s’intéressant à ses incidences en termes de production de récits territoriaux, de l’échelon local au régional. Il s’agira également d’envisager comment les initiatives de l’ESS ancrées localement peuvent contribuer à l’interrogation et à la transformation du global. Ces questions sont susceptibles de trouver un terreau dans chacun des territoires, qui peut opportunément être appréhendé dans une acception d’écosystème englobant les êtres et les choses, le vivant humain et non humain (Latour et Descola, 2021).
Les thématiques traitées pourront aussi porter sur les futurs désirables dans le champ de l’ESS. Là où la coopération mondiale ou globale semble mise en échec, le local regorge de micro-expériences plus ou moins instituées, susceptibles de nourrir des utopies transformatrices au profit d’un bien-être social, économique et environnemental. Le rôle de l’ESS dans l'innovation sociale et la création de futurs possibles peut être ici interrogé.
Il est enfin possible de proposer des communications à propos de l’impact des nouvelles technologies sur les territoires et la démocratie locale. Cette question concerne l’adoption des technologies par les structures de l’ESS, la manière dont elles les utilisent ou tentent de les contenir.
Axe 2 : Quelles transformations écologiques et sociales dans l’ESS et par l’ESS ? Transformer l’ESS(É) ?
L’économie sociale et solidaire a gagné en visibilité ces dernières années, notamment en France avec la loi de 2014 qui a contribué à sa reconnaissance (CSESS, 2023) et à son institutionnalisation (Dreyfus, 2017). Le sigle ESS est utilisé et compris par un cercle d’initiés. Toutefois, certains acteurs ne se revendiquent pas comme appartenant ou ne connaissent pas encore la notion d’ESS, lors même qu’ils en relèvent du fait de leurs statuts juridiques. Aux yeux de ses avocats, l’ESS peut constituer un levier de transformation écologique, dans la mesure où elle priorise l’utilité sociale et environnementale plutôt que les profits et qu’elle favorise le local, l’économie circulaire, la sobriété et la gouvernance participative. Toutefois, les ambitions en termes de changement d’échelle ne semblent pas encore concrétisées (CSESS, 2023). A l’image des analyses effectuées à propos de la transition énergétique (Fressoz, 2024), il est possible de questionner la réalité d’une transition écologique et sociale dans le domaine de l’économie et plus particulièrement dans celui de l’ESS.
Les pratiques de certaines coopératives de l’agroalimentaire interrogent par exemple sur leur modèle environnemental et social, alors qu’elles renforcent et promeuvent une agriculture intensive qui contribue au mal-être animal et humain tout en utilisant des produits d’importations non soumis aux normes environnementales. Toutefois, ce questionnement peut aussi concerner de plus petites structures, comme des associations qui peinent souvent à trouver un équilibre satisfaisant du point de vue social et environnemental lors même qu’elles s’étaient initialement engagées sur ces valeurs. De manière liée, il est également possible de s’interroger sur la mesure dans laquelle les activités liées à la transition écologique (énergie renouvelable, rénovation, mobilité) peuvent contribuer à la concrétisation des valeurs de l’ESS. En d’autres termes, l’économie écologique (Spash, 2013) est-elle sociale et solidaire ?
L’objectif de cet axe est d’interroger les transformations écologiques et sociales portées par l’ESS et leurs incidences, à l’intérieur de ce secteur, mais aussi, par effet d’entraînement, dans l’ensemble de l’économie. Si les dimensions sociale et solidaire constituent les fondements historiques de l’ESS, la transformation écologique est-elle devenue une dimension centrale pour ses acteurs ? Est-il nécessaire d’ajouter un « É » au sigle pour affirmer que l’économie sociale et solidaire est aussi écologique ? L’ESS est-elle par nature écologique ? Contribue-t-elle à la transition écologique ? Toujours sur le registre de la concrétisation des valeurs affichées : le fait de travailler dans un organisme de l’ESS constitue-t-il une garantie effective de meilleures conditions sociales et de plus grande solidarité ? Les structures de l’ESS sont-elles conduites à effectuer des arbitrages en faveur de l’économie et du social plutôt que de l’environnement (fin du mois vs fin du monde) ? La gouvernance partagée est-elle facteur de difficultés dans la gestion quotidienne des structures ? Au-delà des statuts prônant l’horizontalité et la collégialité, la gouvernance effective est-elle plus verticale, notamment du fait des difficultés à concrétiser l’implication collective ?
Une décennie après la promulgation de la loi sur l’ESS et l’accord de Paris de la COP21, une transition sociale, solidaire et écologique dans l’économie est-elle en cours ? Si tel n’est pas le cas à l’échelon global, cette transition se concrétise-t-elle au moins dans le champ de l’ESS ? Les structures de l’ESS sont-elles en mesure d’initier et de favoriser les changements rapides nécessaires pour atteindre l’objectif de décarbonation de l’économie ?
Les propositions de communication pourront s’appuyer sur des exemples concrets pour illustrer les transformations opérées sur certains territoires ou au sein d'organismes de l’ESS. Les études documentant des trajectoires de blocage, de retour en arrière, d’effets de mode seront également appréciées, en particulier lorsqu’elles mettront en évidence les variations observables en fonction des territoires ou des écosystèmes économiques et institutionnels (monnaies locales, tiers lieux, recycleries, matériauthèque...).
Axe 3 : L'ESS pour une société émancipée : identifier, reconnaître, accueillir, rendre visible
L'Économie Sociale et Solidaire (ESS) joue un rôle fondamental dans l'émancipation des individus et des groupes. Au-delà des acteurs professionnels, de nombreux bénévoles portent ses valeurs. L'ESS s'appuie depuis toujours sur l'Éducation populaire pour sensibiliser et former ses publics. L'évolution de cette relation leur permet-elle de soutenir la créativité de l'agir citoyen et ainsi d’inspirer des politiques publiques innovantes à même de répondre aux bouleversements économiques, sociaux et environnementaux de ce début de XXIe siècle ? La reconnaissance des acteurs "invisibilisés", la préservation d'un esprit critique face à l'institutionnalisation, et la capacité à s'adapter aux transformations sociétales constituent également des pistes de recherche essentielles.
Dans les discours et les politiques publiques, certains domaines ou acteurs de l'ESS sont souvent oubliés, sous-représentés ou considérés comme ne relevant pas de l’ESS. C’est par exemple le cas du sport amateur et des 360 000 associations qu’il comporte en France (sur un total de 1,5 million. Ces associations sont rarement perçues comme relevant pleinement de l’ESS, ce qui mériterait d’être interrogé. Cette invisibilité est problématique, car l'ESS doit veiller à ne pas reproduire les schémas de domination, son rôle étant de démocratiser l'économie par l'engagement citoyen (Laville, 2007).
L'émancipation citoyenne dont il est question ici ne se limite pas à un statut juridique, mais se définit comme un sentiment d'appartenance à la cité, par le partage de valeurs et l'action collective. De nombreux acteurs locaux agissent pour répondre aux besoins qui se manifestent sur leurs territoires (Touraine, 1984). Issues de démarches participatives, ces initiatives couvrent un large éventail de domaines :
Les espaces intermédiaires et de proximité – du tiers-lieu au bar associatif (Oldenburg, 1989), en passant par la maison de quartier et le club de sport – constituent de véritables laboratoires où les formes d'apprentissage collaboratif se réinventent (Zask, 2016). Ils incarnent et défendent les valeurs de l’ESS, portées par des millions de bénévoles engagés, et constituent des lieux de questionnement des politiques publiques et de leur efficacité face aux défis de notre époque (Blatrix, 2009). Ces initiatives révèlent un pouvoir d'action qui s'exerce sur le terrain, en dehors des cadres institutionnels.
La double posture des habitants (bénéficiaires et acteurs) favorise-t-elle leur créativité et leur propension à agir sur un territoire (Joas, 1999) ? Le pouvoir d’agir des citoyens est-il réel ou est-il cadré par les injonctions procédant des dispositifs participatifs (Zask, 2011, 2016) ? Comment les représentants traditionnels de l'ESS accueillent-ils ces initiatives locales et projets collectifs indépendants ? L'enjeu est de savoir si ces projets collectifs inspirent de "meilleures" pratiques dans le cadre de l'ESS aussi bien que dans celui de l’action publique (Nicolas-Le Strat, 2015). Parallèlement, l'ESS est de plus en plus institutionnalisée. Comment peut-elle préserver son caractère critique, alternatif et subversif face aux impératifs de la professionnalisation et de la standardisation ? Les principes de démocratie, d'égalité et de juste rémunération sont-ils mis en œuvre et évalués efficacement au sein de ses structures ? En outre, le développement de nouvelles formes d'engagement citoyen peut-il inspirer les politiques publiques de demain ?
Traditionnellement, l'ESS offre des cadres d'expérimentation et d'innovation sociale (Penven, 2016), tandis que l'Éducation populaire forme les acteurs de ce secteur. Les grandes fédérations et mouvements nationaux historiques de l'Éducation populaire (CNAJEP, Ligue de l'enseignement, CEMÉA, Francas, Fédération Léo Lagrange, UFCV) continuent de former les professionnels des associations, coopératives, fondations, mutuelles, représentant plus de 60 % des effectifs de l'action sociale en France (Archambault, 2017). L'Éducation populaire, joue-t-elle encore un rôle dans la transmission et le partage des savoirs dans le champ de l'ESS ? Quel rôle spécifique ses structures jouent-elles dans l'accompagnement et l'autonomisation des citoyens ? Tout en continuant à soutenir l'action citoyenne sur les territoires, l'ESS et l'Éducation populaire peuvent-elles se réinventer pour faire face aux enjeux de demain, qu'ils soient climatiques, sociaux ou technologiques ?
Axe 4 : Entre économie de marché et désengagement des autorités publiques. Les communs un horizon.
Les décennies 1990 et 2000 ont été marquées par une transformation progressive de l’intervention étatique en France. Autrefois caractérisé par une forte implication dans des domaines variés — de l’éducation à l’environnement, en passant par la culture ou le sport —, l’État social a peu à peu cédé la place à un État principalement régulateur (Chevalier, 2004). Plutôt que d’agir directement, il établit désormais des règles du jeu à distance, privilégiant la coordination, la normalisation et l’évaluation tout en déléguant de plus en plus l’action publique. S’il conserve la maîtrise des grands équilibres économiques et sociaux, il agit davantage par l’incitation, la régulation ou la contractualisation (Le Gales, 2003).
Les politiques publiques se sont donc progressivement teintées de néolibéralisme, l’État adoptant une posture de retrait. Dans ce contexte, où l’on connaît l’attachement territorial des structures de l’ESS, quels types d’alternatives celles-ci peuvent-elles offrir ? Quels sont les opportunités et les risques pour l’ESS de se substituer à un État en retrait ? Cette situation ne révèle-t-elle pas aussi la dépendance économique de certaines structures de l’ESS ? Comment, dans ce cadre, réaffirmer la dimension politique de leur projet ? Ainsi, il paraît clairement que l’État reste timide et très mal à l’aise face à l’émergence des initiatives citoyennes. Les recherches traditionnelles d’Ostrom (2010) sur les ressources partagées gérées collectivement par une communauté selon ses propres règles s’opposent à l’organisation hiérarchique et centralisée, qui ne permet pas de comprendre le mode d’organisation horizontal des communs. De même, les formes hybrides mises en place dans le cadre des communs, car elles ne sont ni totalement marchandes ni totalement publiques. De cette façon, les logiques de performance sont diamétralement opposées : d’un côté, un État qui fonctionne de plus en plus selon les critères de rentabilité et d’évaluation quantitative ; de l’autre côté, les communs qui tendent à valoriser les externalités positives (lien social, autonomie ou résilience territoriale). Or ces externalités positives sont difficilement mesurables avec les outils mobilisés par l’État.
La politique sociale d'inspiration néolibérale s'inscrit dans un cadre de rationnement et rationalisation des services publics (Vezinat, 2024). Il ne s'agit pas d'une « alternative libérale » au sens propre du terme, mais bien de l'imposition de logiques néolibérales pilotées par l'État (Dardot et Laval, 2009), l'ESS est-elle en mesure de proposer des voies alternatives de bifurcation et de rupture ? Suivant quelles trajectoires et reposant sur quelles expérimentations ? En effet, on pourrait s’interroger sur les trajectoires que les structures de l’ESS peuvent adopter. Tantôt elles peuvent proposer d’alternatives, mais elles peuvent également se trouver à simplement réguler le système capitaliste sans pour autant le transformer. Ainsi, les contributeurs sont invités à s’interroger sur les difficultés de certaines expériences à se développer à grande échelle, voire aux échecs (tels que les monnaies locales). En d’autres termes, quels sont les obstacles à la construction des communs ? Les approches croisées en ESS et des communs peuvent s’avérer heuristiques en la matière (Ferraton et Vallade, 2019).
Les communs ne constituent-ils pas une piste à explorer ? Les propositions portant sur cette question pourront aborder les thèmes suivants :
Cet axe attend des contributions pouvant explorer de manière conceptuelle et empirique les effets des transformations évoquées et les enjeux soulevés pour l’ESS.
Axe 5 : Dialogues chercheurs-acteurs pour des Sciences Humaines et Sociales engagées dans la transformation sociale
Les « recherches participatives », soutenues par des dispositifs comme le programme « Sciences avec et pour la société » (ANR) ou l’appel à projets « Recherche et société » (Conseil régional de Bretagne), remettent en question les frontières classiques entre production scientifique, action sociale et engagement politique. Ces démarches, qui favorisent la coproduction de savoirs entre chercheur·e·s et acteur·rice·s de terrain, ne se contentent pas de décrire le réel : elles visent à le transformer.
Dans le champ de l’ESS, cette approche trouve un terrain fertile. Historiquement nourrie par des traditions de recherche-action et de pratiques coopératives, la recherche en ESS s’inscrit souvent dans une volonté de produire des savoirs utiles, ancrés dans les réalités sociales et critiques vis-à-vis des logiques dominantes. Les méthodes de travail coopératives, intégrées et interventionnelles (Desgagné,1997) sont maintenant mobilisées de manière privilégiée pour faciliter la transition.
En ce sens, elles rejoignent les principes de la recherche et développement social (R&D sociale), tels qu’ils ont notamment été conceptualisés par Jade Omer, dans l'objectif de renforcer la capacité des organisations et des communautés à innover socialement en s’appuyant sur la coconstruction des savoirs. La R&D sociale met en avant une vision transformatrice de la recherche. Elle ne se limite pas à l’analyse, mais cherche à produire des leviers de changement, à la fois pratiques, politiques et symboliques.
L’émergence de structures de recherche alternatives (collectifs, coopératives, associations), souvent impulsées par de jeunes chercheur·e·s, illustre ce renouvellement des manières de produire des savoirs. En s’ancrant dans des terrains souvent marginalisés, ces initiatives contribuent à redéfinir les contours de la légitimité scientifique, tout en expérimentant de nouveaux modèles économiques et organisationnels de la recherche. Elles participent également à une reconnaissance accrue des acteur·rice·s de l’ESS comme partenaires à part entière dans la production de connaissances, et non comme de simples objets d’étude. Cette reconnaissance passe par la valorisation de leur expertise d’usage, leur rôle dans l’expérimentation sociale, et leur capacité à proposer des alternatives concrètes aux modèles dominants.
Enfin, dans un contexte où la participation devient parfois une norme et est instrumentalisée, il est crucial de distinguer les démarches véritablement transformatrices de celles qui reproduisent des formes de domination ou d’extraction. Cela implique de prendre au sérieux la portée politique des recherches partagées, et leur capacité à modifier les équilibres entre savoirs experts et savoirs situés. Reconnaître pleinement la légitimité des acteur·rice·s de l’ESS dans ces dynamiques de recherche, c’est aussi interroger les hiérarchies de savoirs, les critères d’évaluation scientifique et les rapports de pouvoir institutionnels qui conditionnent encore trop souvent leur visibilité et leur contribution.
Ces démarches appellent ainsi à interroger plusieurs dimensions essentielles :
Cet axe attend des communications s’appuyant sur des expériences concrètes de recherche participative, collaborative ou de R&D sociale dans le champ de l’ESS. Les propositions pourront explorer les démarches méthodologiques et théoriques mobilisées, les effets produits sur les pratiques sociales ou professionnelles, les tensions rencontrées dans la collaboration et les conditions de possibilité d’une véritable transformation sociale par la recherche.
Format des propositions :
Les intentions de communication, d’une page et demie maximum (2 500 caractères), doivent préciser le titre de la communication, l’axe thématique de l’appel à communications privilégié, l’objet traité et la problématisation, le ou les terrains et matériaux, la ou les méthodes mobilisées, l’originalité et l’ambition des résultats attendus. Une courte bibliographie est attendue (5 à 10 références maximales).
Chaque proposition sera évaluée en double aveugle par le comité scientifique des 25e Rencontres. Les propositions de communication doivent prioritairement s'inscrire dans l’un des cinq axes, mais des communications hors axes peuvent être acceptées si elles s’inscrivent dans la thématique générale du colloque.
Nous encourageons vivement la soumission d'études de cas ancrées dans des réalités territoriales, afin de mettre en lumière la diversité et la richesse des dynamiques locales, dont l'analyse saura inviter à une réflexion prospective. De même, les écritures à quatre mains, impliquant un-e universitaire et une personne de terrain (professionnelle ou bénévole), seront appréciées. Il s'agit de dessiner ensemble les voies d'une transformation continue, où désirs et réalités s'entremêlent pour construire un avenir plus équitable.
Les projets de communication sont à adresser à :
Site : https://riuess2026.sciencesconf.org/
Pour toute question, vous pouvez écrire à : riuess2026@sciencesconf.org
Calendrier indicatif :
Comité d’organisation :
Pascal Glémain (Université de Rennes 2), Hervé Hudebine (Université de Bretgne Occidentale), Soaz Jolivet (Université de Bretagne Occidentale), Thierry Michot (Université de Bretagne Occidentale), Marion Michelin (CRESS de Bretagne), Jorge Munoz (Université de Bretagne Occidentale), Nicole Roux (Université de Bretagne Occidentale), Pierre Servrain (Université de Bretagne Occidentale), Yannig Robin (Université de Bretgne Occidentale), Jérôme Sawtschuk (Université de Bretagne Occidentale).
Comité scientifique :
Marina Aguilar Rubio (Université d’Almeria Espagne), Daniela Audivet (Université de Valence Espagne), Paloma Bel Duran (Université Complutense Madrid Espagne), Melaine Cervera (Université de Lorraine), Marie Fare (Université de Lyon 2), Laurent Gardin (UPHF Valenciennes), Pascal Glémain (Université de Rennes 2), Vincent L'huillier (Université de Lorraine), Valérie Billaudeau (Université d’Angers), Josette Combes
Eric Dacheux (Université Clermond Auvergne), Herve Defalvard (Université Gustave Eiffel), Millan Diaz Foncea (Université de Zaragosa Espagne), Timothée Duverger (Sciences Po Bordeaux), Cyrille Ferraton ((Université Montpellier 3), Patrick Gianfaldoni (Université d’Avignon), Daniel Goujon (Université de Saint-Etienne), Soaz Jolivet (Université de Bretagne Occidentale), Alexandrine Lapoutte (Université Lumière Lyon 2), Emilie Lanciano (Université Lyon 2), Gustavo Lejarriaga Pérez de las Vacas (Université de Complutense Madrid Espagne), Laetitia Lethielleux (Université de Reims Champagne-Ardenne), Julien Maisonnasse (Université d’Aix-Marseille), Deolinda Meira (Université de Porto-Iscaap Portugal), Abdourahmane Ndiaye (Université de Bordeaux), Raquel Pereira (Université de Porto-Iscaap Portugal), Francesca Petrella (Université d’Aix-Marseille), Mario Radrigan Rubio (Université de Santiago-Chili), Nadine Richez-Battesti (Université d’Aix-Marseille), Yannig Robin-Vigneron (Université de Bretagne Occidentale), Elodie Ros (Université de Paris 8), Sandrine Rospabé (Université de Rennes 1), Josiane Stoessel-Ritz (Université de Haute-Alsace) Sébastien Le Foll (Université de Rennes 2), Maria José Vaño Vaño (Université de Valence Espagne).
Références Bibliographiques
Archambault E. (2017), Le secteur non lucratif : Économie et gestion. Economica.
Blatrix C., (2009), La participation locale : entre engagement citoyen et action publique. L'Harmattan. Chevallier J., (2004), « L’État régulateur », Revue française d’administration publique, N° 111, p. 473482.
Demoustier D., 2010, « Economie sociale et solidaire et régulation territoriale. Etude sur quatre zones d’emploi en Rhône-Alpes », Géographie, économie et société, Vol. 12/1, p. 89-109.
Desgagné, S. (1997), « Le concept de recherche collaborative : l’idée d’un rapprochement entre chercheurs universitaires et praticiens enseignants »Revue des sciences de l’éducation, Volume 23, Number 2, p. 371–393.
Dardot P. et Laval C., (2009), La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale, La Découverte.
Dreyfus, M. (2017), Histoire de l’économie sociale, de la Grande Guerre à nos jours. Rennes, PUR.
Ferraton C. et Vallade D., (2019), Les Communs, un nouveau regard sur l'économie sociale et solidaire ? Pulm,
Fressoz, J., B. (2024). Sans transition : une nouvelle histoire de l'énergie, Paris, Seuil.
Joas H., (1999). La créativité de l’agir. Cerf.
Latour, B. et Descola, P. (2021), Penser le vivant. LLL Les Liens qui Libèrent.
Laville J-L, (2007), L’économie solidaire. Une perspective internationale, Hachette Littératures.Le Gales P., (2003), Le retour des villes européennes. Sociétés urbaines, mondialisation, gouvernement et gouvernance, Paris, Presses de Sciences Po.
Gianfaldoni P., Richez-Battesti N. et Fraisse L. (2024) (dir.), Quand l’économie sociale et solidaire fait territoire, Avignon, Editions Universitaires d’Avignon.
Nicolas-Le Strat P., (2015), Agir en commun-Agir le commun, éditions du Commun.
Ndiaye, A. (2025). « L’économie sociale et solidaire prise entre valeurs ancestrales et transition sociale-écologique dans les Suds. » Marché et organisations, 54(3), p. 5-21.
Oldenburg R., (1989), The Great Good Place. Da Capo Press.
Omer, J., Ferru, M., & Réale, M. (2024). La recherche et développement sociale : apparition, contours et principes. Management international.
Ostrom E. (2010), (1990 première édition), Gouvernance des biens communs, pour une nouvelle approche des ressources naturelles, Editions De Boeck.
Paquot, T. (2011) Qu’est-ce qu’un territoire ? Erès, Vie sociale, 2, p. 23-32.
Parrique (2022), Ralentir ou périr, Paris, Seuil.
Penven, A., (2016), Sociologie de l'action créative : expérimentation sociale et innovation, L'Harmattan.
Recma, (2021), numéro 359, Utopies réelles.
Spash, C. L. (2013). The shallow or the deep ecological economics movement?. Ecological Economics, 93, 351-362.
Touraine A., (1984), Le retour de l'acteur. Fayard.
Vezinat N., (2024), Le service public empêché, Paris, Puf.
Zask J, (2011), Participer. Essai sur les formes démocratiques de la participation, Paris, Le Bord de l'eau. Zask, J., (2016), La démocratie aux champs, Du jardin d'Éden aux jardins partagés, comment l'agriculture cultive les valeurs démocratiques. La découverte. |